Mon travail consiste à réaliser des assemblages avec ce que l’on considère comme déchet ou obsolète, que je glane. Il s’agit de matières organiques, plastiques et d’objets du quotidien porteurs de gestes. Je les trouve lors de déambulations dans l’espace public et la nature plus ou moins apprivoisée.
Avec ces assemblages je compose des installations in situ. J’associe inerte et vivant en intégrant de plus en plus de jardins miniatures à mon travail. Cela implique de prendre le temps, de respecter une temporalité. Je tisse du lien entre intérieur et extérieur, le «je» et le «nous». Par les croisements des techniques vernaculaires, souvent de confection et la merveilleuse contingence, mes recherches plastiques s’apparentent à une enquête anthropologique. Une quête à l’esthétique ambivalente et natureculturel qui alimente un humanisme non-anthropocentré. Il est donc question de mémoire, de territoire, de notre relation au monde, à l’Autre et à notre environnement.
Dès mes premières expositions, certains visiteurs m’ont spontanément apporté des cadeaux-trésors ramassés lors de balades. A présent, je lance des appels aux glaneur.ses selon les besoins de ma création. De ces collectes, naît ma palette. Les mains sont les ultimes outils d’expression du Je dans un présent discontinu et perpétuel.
Lucie Bayens 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je suis artiste plasticienne. Je vis et travaille à Bordeaux, ville où je suis née. Au quotidien, lors de mes pérégrinations ou simplement mes déplacements, je prélève des matières organiques et plastiques dans la rue, au bord du rivage ou dans la « laisse de mer ». Ainsi je me sers du territoire comme d'une caisse de résonance, avec pour fil conducteur, le passage de l’eau, le réseau. Pour désigner ces prélèvements, j’emploie le verbe « glaner » en hommage aux «gens de peu» qui font avec les moyens du bord. A l’atelier, je nettoie et classe puis je les assemble, souvent en cousant, brodant ou tressant. Les objets d’art ainsi composés sont autant de trilogues entre l’idée, la main et la matière.
Il n’est pas rare que lors d’expositions auxquelles je participe, je rencontre des spectateurs curieux qui apprécient le geste de ramasser et souhaite participer à mon travail en me faisant don de cheveux longs perdus, de filets en plastiques ou d’os animaux trouvés lors de balades en montagne ou en forêt, par exemple. Ainsi, grâce aux rencontres provoquées par l’art, une équipe de «glaneurs» à géométrie variable s’est spontanément constituée. Merci à eux <3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrouvez moi sur https://www.instagram.com/luciebayens/ Artiste // Bx // trottoirs // lignes // lumière // rivière // plante // langage // littoral // glaner // atelier // exercice quotidien // journal de bord // VADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artiste plasticienne, je vis et travaille à Bordeaux. Je réalise des sculptures à la jonction de Nature et Culture afin de composer des installations. Mon travail prend ses racines dans le non-sens de cette dualité. Il est marqué par le temps long de la confection et de la germination. Je me sers du territoire comme d’une caisse de résonance. Je glane les infamies sur les rivages, dans la nature plus ou moins apprivoisée puis, j’agence des objets d’art en oxymore où les mots touchent la chair. Je fais vibrer les signes et tisse des liens à l’aide de techniques vernaculaires. Je transgresse la tradition du geste, ce qui donne une certaine ambivalence formelle à ma recherche. Ces objets sont des acculturations qui tendent des ponts entre sauvage et civilisé pour mieux construire, tout contre le barbare.
Spontanément, certains visiteurs d’expositions ou d’atelier m’ont apporté des abjects d’origine animale, végétale ou plastique trouvés dans la cuisine ou lors de promenades, afin de participer activement à cette néguentropie. Depuis j’invite les spectateurs à glaner, dans leur quotidien, puis à me faire don de ces trésors qui constituent ma palette, donnant ainsi la part belle à la contingence et résistant à une vision utilitariste de notre environnement et ce qui le compose. Suivant la définition de Schopenhauer, pour qui l’art est la communication universelle d’un secret qui modifie le sujet et l’objet pour percer au jour le vouloir vivre; Les allers-retours entre les différentes techniques, supports et matières utilisées, ainsi que les glissements sémantiques m’offrent un espace de devenir.
J’ai toujours vécu au bord de l’eau. Depuis l’enfance, j’y observe la nature et les hommes, dans leur alternance de calme et de violence. L’eau et sa trajectoire occupent une place centrale dans ma pratique car «L’histoire d’un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l’histoire de l’infini» Elisée Reclus.
Lucie Bayens 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

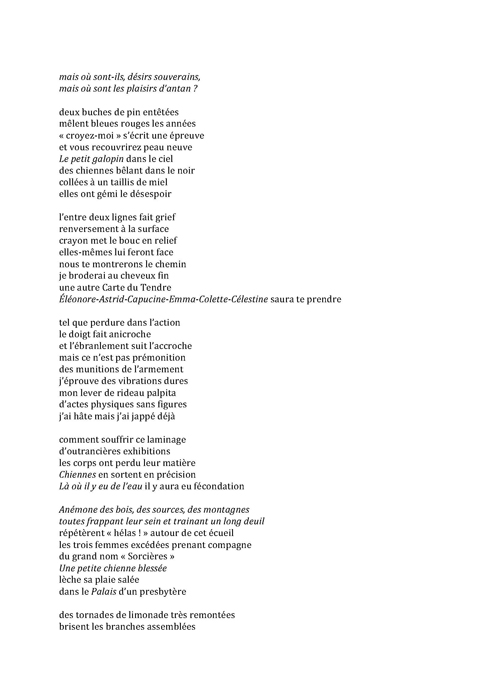
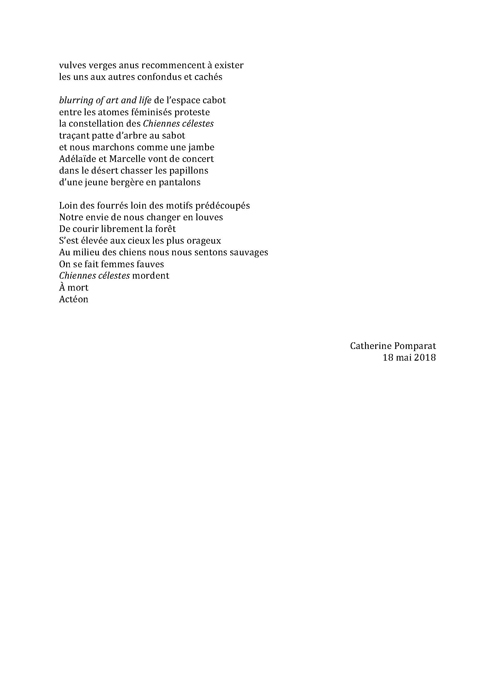
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au bout du continent, des rives avec Lucie Bayens
- par Valérie Champigny le 7 mai 2014 à l'occasion de l'exposition personnelle
« Lundi ou la vie sauvage » à la Laiterie, Bordeaux.
Lucie Bayens expose « Lundi ou la vie sauvage » du 9 au 28 mai à La Laiterie à Bordeaux : une œuvre sur des préoccupations sociétales, écologiques et scientifiques.
Au commencement de l’exposition, il y a la rencontre avec l’animal comme pour nous proposer d’adopter un autre point de vue sur l’humain que celui de l’homme. Lucie Bayens en tentant d’associer le sauvage au domestique construit une matière poétique sous la forme d’une mythologie vernaculaire où l’homo faber, l’homme qui fabrique, et l’homo ludens, l’homme qui joue, retrouvent pleinement leurs droits.
Au bout du continent, pas à pas sur la rive
L’action se situe « au bout du continent » : Lucie Bayens vit et travaille à Bordeaux, ville de transit par son histoire. Elle construit sa pensée au cours de ses marches entre les rives de la Garonne en crue, le bord de l’océan, dans les forêts landaises… « Et d’ailleurs la signification propre d’une œuvre n’est-elle pas celle qu’elle est susceptible de prendre par rapport à ce qui l’entoure ? » (André Breton, « Les Pas perdus »).
Le propos n’est donc pas seulement construit sur une matière poétique mais il s’appuie sur des préoccupations sociétales, écologiques et scientifiques. Aucune des pièces réalisées ne vient comme la réponse à un questionnement. Chacune d’elles conduit le regardeur à explorer une problématique complexe.
L’ici et le maintenant
La pratique de Lucie Bayens est protéiforme, tentaculaire avec pour fil rouge un univers rempli de formes mutantes, de territoires, de fleuves. On trouve des dessins brodés avec des cheveux, des bois pyrogravés, des peaux animales cousues… Le travail s’étend par lui-même et mélange les approches, multiplie les regards. Les pratiques réunies amplifient la force de l’imaginaire.
L’enjeu est d’une étonnante continuité dans le détournement total des techniques savantes, des usages ancestraux au profit d’une réflexion sur l’ici et le maintenant tout en poursuivant une exploration où le réel et la fiction échangent des données et nous projette finalement face à ce que l’on témoigne de notre époque. Et la cohérence vient de là.
Ralentir le temps…
Les œuvres ont une apparente légèreté, simplicité qui s’oppose à leur process empreint d’une expérience cognitive de la vie courante, de marches et de réflexions sur les rebuts de notre société.
Parcourir les berges, les forêts, la ville
L’intention artistique chez Lucie Bayens nait de « l’expérience du trajet parcouru » chère à l’artiste-marcheur Hamish Fulton, et de l’observation aiguisée des formes de vie, de lieux. La marche implique de considérer dans une hyper-disponibilité à l’événement, à l’espace de prospection. Ensuite vient la récolte en vue la réappropriation d’éléments, la brande récoltée en forêt, les bois flottés, les rebus, dans le champ sublimé de la rematérialisation à l’œuvre. La nature est tout, sauf morte, rien ne se perd.
La collection d’échantillons : un lexique empirique
Le processus dans l’œuvre de Lucie Bayens est construit par des collectes d’éléments très divers dans les espaces dits « naturels » ou au cœur de la ville notamment sur les rives de la Garonne. Ils sont répertoriés sous forme d’échantillons « vitrine », une grammaire de réflexion qui cartographie ses déplacements. On y trouve un échantillon de la collection des « larmes de sirènes », ces granulés plastiques d’origine industrielle éparpillés sur les plages avec les macro-déchets dérivants, traces d’une société consumériste. Il s’agit de récolter des données pour nous soumettre des raccourcis audacieux et féconds.
Chaque collection (bois, os, peaux…) se complète d’années en années sans pour autant être inachevée : elles se chargent de sens au fur et à mesure des ajouts. Chaque geste précis se rajoute au précédent, identique et pourtant différent dans la réappropriation de certains savoir-faire traditionnels. Il en résulte des œuvres habitées par le temps long autarcique du process ainsi que par le détournement de ce que serait le geste répétitif d’une chaine d’usinage d’objets normés. La fonction se déplace.
Règne animal, approche magique ou scientifique ?
Lucie Bayens garde en mémoire de l’enfance les images de l’abattoir, les lamproies suspendues, le sang, les os, un théâtre qui raconte le monde, le passage de la vie à la mort.
Le castor des marais
Mi-animal, mi-végétal, ce « ragondin » mutant, cousu d’écailles de pommes de pins provenant des Landes issues d’une culture artefact intensive. Ce travail méticuleux inspiré de technique du sequin en confection détourne pour mieux mettre en évidence les paradoxes de nos comportements dans notre retour à la nature, création d’éco-quartiers en bord de marais… Les ragondins de Bordeaux ont colonisé depuis des décennies la plupart des plans d’eaux douce de la Gironde et sont considérés comme un rongeur nuisible.
La cabane à voute
« Borie de chien » est une sorte de niche faite d’os, de carapace qui renvoie aux besoins vitaux : l’abri et la nourriture. Les ossements utilisés comme matériau de production artistique sont support de réflexion sur l’anthropologie du quotidien. Les assemblages d’ossements rappellent des techniques utilisées pour les ornements des peuples premiers. Ici, la collection en os renvoie aux détournements que l’homme impose à une évolution naturelle puisqu’il s’agit d’animaux d’élevage.
Par métonymie on passe d’un objet à un être : l’abri et le sans-abri dans une société qui ne protège plus, où l’humain est son propre prédateur – et où « il nous faut laisser le moins de plumes possible ». On pense au « Bread bed » de Jana Sterbak. Le mythe du Robinson naufragé se prolonge à travers le sens de la protection sociale devenue précaire.
Sur les étendues de sel marin
Des jouets et des protections d’extrémités, chaussures, moufles, balles, ballons forment une installation « Inuit des Landes » réalisée à partir des ressources naturelles disponibles, locales : la peau de canard épaisse semble parfaite pour s’acclimater à un biotope hostile ou froid, réminiscence du temps de neige évoqué par la présence du sel marin, blanc immaculé.
Le sel devient un support fictionnel, une île dans l’espace d’exposition sans pour autant être un non-lieu. Le sel est aussi le moyen de conservation de cette collection.
Retour du règne animal ?
Pas nécessairement : l’objet prend une dimension « magique » quand son sens dépasse sa finalité formelle pour prendre sens dans une valeur d’usage. Lucie Bayens compose des objets porteurs d’une force visuelle, un bestiaire magique, des outils polémiques aux multiples facettes. Chacune de ses pièces propose diverses lectures : celle du sorcier, du mystique, ou encore celle du scientifique, du généticien, du prédateur ou de la proie.
On trouve dans la collection d’échantillons « vitrines », une liste de courses gravées sur un os, témoin de notre société consumériste futile. La liste est ici fixée de manière temporelle durable, la question posée semble de réveiller les consciences sur les traces que nous souhaitons transmettre de notre civilisation. Lucie Bayens joue de la notion d’authenticité en incorporant des matières plastiques pour leurs propriétés, leurs colorations, leur origine, et leur usage local et opère un décalage dans la finalité de leurs fonctions qui dépasse l’approche ethnographique.
La couture comme une greffe
L’artiste recycle essentiellement des rebuts : filets d’oranges, ossements et peaux d’animaux, glands de chênes…
L’action de tisser, de coudre, est répétée inlassablement et raisonne selon la logique propre des matériaux qu’elle rencontre. On y retrouve toujours une simplicité dans le geste choisi (tracer une ligne, coudre, assembler, compacter).
Lucie Bayens tisse du sens avec des fils de pêche, des cheveux. La broderie minimale de Lucie Bayens dessine par le cheveu imputrescible parfois de la couleur du support. Le cheveu poursuit sa ligne et ajoute des seuils de transparences à des représentations telles que la « Danse frétillante de l’abeille » ou la « division cellulaire » ou les contours du « Gulf stream » – comme si par le choix pour la représentation de ces motifs, d’une pratique délicate, Lucie Bayens nous questionnait, non sans ironie, sur l’apparition de la vie et les usages appliqués de la science.
Au fil d’une écriture
Les dessins et la broderie se lisent comme une écriture insistante par son caractère graphique, tandis que les mots tamponnés sur les intestins de porc, font « image » à la manière d’une signalétique.
Le message est ici fixé à l’heure où l’information est engloutie dans un flux numérique. La dimension dialectique de ses modèles poétiques et le rapport aux matériaux naturels ou transformés forment tandem indissociable et évocateur. « Charnières », l’ornementation pyrogravée sur des bois flottés, représente des armes à feu. L’assemblage des bois comme celui d’un feu de bois vient lui donner une autre densité aux représentations gravées.
L’espace d’exposition, un territoire en expansion
Lucie Bayens est un artiste du faire, du sensible. « Que faut-il alors entendre par œuvre ? Œuvre qui vient du latin opera, travail, soin, a hérité de plus en plus des sens d’opus : travail, mais aussi résultat du travail, chose fabriquée » (Fabienne Brugère, professeur de philosophie à l’Université de Bordeaux 3, « La disparition de l’œuvre »). Dans la démarche de Lucie Bayens, le concept naît des pérégrinations en Aquitaine et de la forme : c’est l’agencement des matériaux dans le temps qui donnent naissance à la pièce qui fait œuvre.
Une cartographie autour de la Garonne
Lucie Bayens au delà de créer des pièces, chorégraphie l’exposition « mise en œuvre » pour nous « déboussoler ». Elle « magnétise » l’espace avec les 4 éléments comme des points cardinaux, l’air, le chaud et le froid, et principalement l’eau. Le cinquième s’ajoutera avec la lecture du regardeur dans la circulation de l’espace guidé par le fil rouge. La « Garonne », une longue tresse rouge de 15 mètres faite d’innombrables filets d’oranges comme une carte du ciel, une carte « vitale » qui contient l’histoire du commerce fluvial et draine un mur entier de l’exposition.
Lundi ou la semaine en marche
Via la métamorphose de ces objets ou rebus préexistants, Lucie Bayens déplace le regard du spectateur pour l’amener dans le champ de projection de l’imaginaire « Lundi ou la vie sauvage » dans un monde contemporain ou le lundi, 1er jour de la semaine d’un travail qui consiste à repenser le monde. Elle semble portée par une distance de quelques siècles à venir, à la manière d’un anthropologue qui se pencherait sur notre mode de vie actuel pour le saisir avec ses contradictions.
Des influences transversales
Les œuvres singulières de Lucie Bayens, chercheuse téméraire aux influences transhistoriques nous renvoient autant à l’arte povera, et notamment Penone, Wim Delvoye, qu’à l’utilisation de techniques ornementales issues des arts premiers. Le lien à histoire de l’art est présent mais au même titre que la science ou l’anthropologie ou la littérature. Lévi-Strauss a défini le problème de l’humanisme dans le fait qu’à force de séparer l’homme de la nature sauvage – maîtrise du feu, puis du végétal par l’agriculture, l’animal avec l’élevage –, on finit par exclure et séparer… Tous les gestes de Lucie Bayens tendent à lier, assembler, à provoquer l’altérité, à réconcilier l’homme comme faisant partie d’un tout.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un texte de Claire Paries écrit à l'occasion de IL FAUT VIVRE; Exposition réalisée avec William Acin à la Chapelle St Loup, St Loubès, Gironde, France, avril 2013. Invitation Siona Brotman.
Des vêtements cousus main et conservés au sel, un tas de bois, des maximes au mur : à première vue des objets disparates mais qui ont en commun une certaine vulnérabilité.
Les bois qui ont perdu leur écorce sont ces bois flottés, roulés, lavés, essorés, par les eaux des rivières, fleuves et océan et qui ont échoué sur les plages. Arbres déchus, frottés ainsi à la vitalité des eaux, ils semblent comme dénudés jusqu’à l’os. Formes aussi organiques que celles produites à partir des peaux ou viscères d’animaux dépecés, consommés sans doute. Epidermes qui ne sont pas sans évoquer ces cours des fermes où on élève les canards gras et où on tue encore le cochon. Des objets qui ont été tous constitués de la perte, l’altération voire la mort.Les bois, comme des ossements sont mis en tas pour un titre féminisé : Charnièr-e qui vient évoquer de manière qui se veut peut être distraite les horreurs de la guerre. Charnière qui est jointure, articulation pour une dérive du sens qui puisse installer un entre-deux. Le bout de bois échoué va se déplacer vers le fusil ou le pistolet brandi, substitut des petits garçons qui permet de se tirer de tous les embarras de ce monde dans lequel il faut bien grandir. Et ce parce que c’est avec la délicatesse d’une fille qui s’approprie les armes de l’enfance que Lucie Bayens a gravé patiemment sur les morceaux de bois, des fusils d’assaut, des armes à feu, en figurines patientes comme les petits points d’un ouvrage de dame. Signes noirs, brûlures de la pyrogravure pour « faire feu de tout bois », utiliser ce qui vient, ce qui se trouve là et engager un dialogue complexe avec la vie actuelle.
Récolter, trier, laver, sécher, traiter pour conserver, puis assembler, coudre ou tamponner d’encre des peaux pour quelques mots échangés ou pour un vêtement réinventé sont autant des gestes de l’artiste.
Les messages sont sibyllins, injonction ou affirmation répétée sur ces corps plats et minces d’enseignes aux formats et contours sensibles dont on a envie de dire qu’ils n’ont que la peau sur les os. Messages proposés comme des « os à ronger » qui ne sont pas sans évoquer du coup la consommation de la chair. A dévorer du regard entre amour et cannibalisme.Les vêtements sont pour les pieds ou les mains, moufles, bottes ou chaussons, à moins qu’ils ne viennent couvrir des objets choisis. Les peaux de canards gras épaisses, cousues de laine, constituent des carapaces souples protectrices des extrémités des corps qui ainsi couvertes seraient alors empêtrées, immobilisées par la graisse trop enveloppante, privées à la fois de la marche et du faire, en devenir objet, corps chosifiés que le sel nécessaire à la conservation achèverait de statufier.
Lucie Bayens se décrit elle-même comme une « glaneuse » : une femme qui se penche vers le sol, attentive, à l’affût, pour une récolte de ce qui oublié ou rejeté pourrait se perdre définitivement. Et d’un lieu à l’autre, elle déambule, flâne, vagabonde pour récolter et amasser. Ce qui la rapproche aussi de la figure du « chiffonnier » :
« Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu’elle a perdu, tout ce qu’elle a dédaigné, tout ce qu’elle a brisé, il le catalogue, le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent ; il ramasse comme on avale un trésor, les ordures qui remâchées par la divinité de l’industrie, deviendront des objets d’utilité ou de jouissance. » Robert Walser dans la Promenade. Cité par Thierry Davila dans Errare humanum est (remarques sur quelques marcheurs du XX° siècle). Les figures de la marche.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucie Bayens : Une plume dans l’édredon de l’ogresse (Par Christophe Massé)
« Ce serait vraiment du temps perdu répondit-elle. Jamais on a vu les gens se savonner le dos » Gabriel Garcia Marquez
Eloge du décoratif dans les travaux de l’Artiste. Je plaisante.
1/ Décoration & mérite.
Une idée du décoratif
Dans ce champ de mines qui propose à la rétine un paysage pictural prêt à combler le temps entier du regard et apporte une extension décorative aux propos liés à la lente et commode transformation de la nature contrariée en espace réel de renaissance ; je découvre que les travaux de Lucie Bayens se situent fréquemment à la limite de cette circonférence inattendue. Je veux dire dans le périmètre, la ligne ténue de démarcation sensitive qui sépare la jouissance visuelle de l’amateur d’art de celle du branleur de cortex.
Ni en dedans, mais pas encore en dehors. Pourtant les sentiments éprouvés sont tous dans un même camp.
Ses œuvres proposent à la pupille dans son instant de dilatation, d’intégrer la voix, le songe de l’artiste dans son extension créatrice, lui confiant le parcours – et si nous abattions l’animal et si nous décortiquions la graine et si l’écorce devait livrer plus encore d’elle, en direction d’une multitudes de mises au point : focus, autofocus et présence d’intériorité/extérieure. Denrées, perceptions rares qu’un spectateur type va pouvoir, dans sa frénésie à sous estimer ses potentialités sensorielles, comme sa pleine responsabilité d’ailleurs ; oublier là, totalement, et reprendre son rôle pour entrer de plein pied dans la mare de l’art, et ainsi revêtir un habit en gras de magret tatoué.
Je l’imagine tenant les couverts, et au beau milieu d’un instant de découpe, s’adressant à la « maîtresse » de maison d’un ton enjoué : Ces couverts sont d’une douceur incroyable. Mais, ne craignez-vous pas que quelques touffes de poils se retrouvent dans les assiettes ?
Oublier, pour sortir de table. Et prendre trois choses : La nature, l’objet, l’humanité ; enfin au sérieux.2/ La préhistoire de l’interférence entre matériel et idées.
L’objet en soi. Mais d’où vient-il ?
Jamais comme durant ces dernières décennies, les artistes contemporains ne se sont autant précipités à la recherche duready made perdu. Une toute nouvelle génération d’artistes a, elle, entrepris de se saisir de l’occasion de ne plus utiliser le pinceau, et pour ; dans ce bouleversement qui a ramené le pécher rétinien à l’ordre du jour ; c’est à dire : du décoratif assumé et sans vergogne à qui mieux mieux sera le plus narquois, tout en se servant dans le grand magasin de l’art et aussi chez de petits fournisseurs de qualité, retrouver la noblesse du message, la puissance évocatrice de la métaphore, par exemple, sur des intestins de porc marouflés après nettoyage sur contreplaqué de bois, qui faciliteront le transit d’interprétation, en réinvestissant dans les cervelles troublées, une belle décharge émotionnelle, en même temps que cette formidable idée illustrée, parce que ce que nous disons n’est pas toujours comestible, ni subliminal, qu’il s’agisse d’aimer comme d’être bien gavé.
De son absolu cheminement : allant du champ d’art sociétal virtuel à celui d’un nouvel art vivant, en composant avec les fabriques administratives ; de gestion langoureuse des patrimoines ou prêteuses nerveuses d’art sur gages, nous avons progressivement recherché dans les espaces qu’ils nous proposent, la véritable condition de l’objet d’art, ramené ! Que dis-je traîné… de son lieu d’introspection initial à celui d’investissement en options à taux préférentiels, comme dans une quintessence en route pour la joie, et avec comme but inavoué d’arriver fondamentalement à croire aux pouvoirs des œuvres, pour qu’ainsi dans nos intérieurs domestiqués, nous renouions avec le geste pur - vlan badaboum - un bon coup de perceuse dans la cloison, suivi d’un planté de cheville hors normes et zou ! En suspension l’œuvre est là, en concurrence directe avec l’écran plat et la voix de son maître.3/ Le partage : images d’errances, notes & attirances, profits.
Parfois l’on sent étrange que dans ces toutes nouvelles propositions se vautrent, confrontés ; d’une part les matériaux issus de la manufacture la plus ancienne des hommes et de l’autre cette invraisemblable boulimie, propre au progrès incessant. Effervescence naturelle qui rejaillit de PARTOUT, par chaque interstice où courageusement elle peut reprendre sa force. Pulvérisée par les myriades de gouttelettes venues du geyser du déballage politique et d’histoires plus ou moins redessinées à la comme ça m’arrange.
Comme si une société toute entière subissait les assauts d’une terrible maladie. Pansements, coutures express sur douleur et maux intenses permettent ainsi d’établir toute une gamme de propositions de soins palliatifs ; elles, flirtant du secteur plastique à son intellectualisation, pour ne pas dire de la réalisation de l’oeuvre au manuel d’utilisation.
Je ne te dis pas le boulot !
Lucie Bayens travaillant sur des matériaux liés aux superpositions de savoir observé : bon et mauvais, gras et maigre, en chair, en os, de la crème et du moisi, de la couenne et du truand, de son alvéole, de la peau, conduit directement à cette troisième phase du regard et nous protège en quelque sorte, nous économise, nous berce, nous illumine la crasse de notre intérieur. Nous ne sommes plus dans l’extrait d’aloe vera, la jouvence, le baume, l’élixir, et j’en passe. Nous nous situons exactement là où c’est fondamental. Justement dans et par la création comme une plume qui se ouatedans l’édredon de l’ogresse. Multiplier les errances et les allers-retours, sans en faire une loi, me parait symptomatique de l’à-propos de cette nouvelle génération d’artistes au regard tendre et parfois (dés) abusé avant l’heure.
Actuellement confronté à l’œuvre en totale expérimentation, je pose mon front sur la vitre. Détendre. Posé un regard tendre et à la fois confus, ou propulsé dans ce nouvel élan de créativité, ce paramètre que j’affectionne depuis de nombreuses années : tout et son contraire se révèle et à défaut d’adrénaline crache de l’émoi – champignon naissant dans la plinthe d’un appartement bourgeois, petite fleur jaillissant du béton sur la façade au dix-huitième étage d’une barre d’immeuble. Le coloré, le clair, le tendre, le caustique, sans jamais se dire que nous pourrions passer de l’un à l’autre et la dernière fois où me sont apparues les couennes de magret gravées, j’avais eu la certitude, un instant, me référant à l’expérience de mangeur exceptionnel de maigre que je suis, et sans demander plus de cuisson, ni implorer quoique ce soi, selon mon habitude, me délectant de contempler petits chaussons cousus main posés délicatement sur le gros sel, et tant l’exercice relevait de la prouesse, en jouir. Pleins les yeux. Prendre une décision. Je me suis toujours prodigieusement ennuyé dans cette histoire de devoir faire des choix. La même histoire que le processus. J’aime les artistes qui ne sont pas dans cette lignée. Le temps qui s’en va a renforcé cette conviction. L’art n’est pas un processus. Même si tous les artistes qui doivent réussir finissent par s’y conformer.3bis/ Porosité
Que la lecture se fasse dans le bon sens. Réinitialisé mes codes. Lucie Bayens est poreuse. Et je le suis devenu un peu plus, mais pas à son contact. Pourtant les explications sont toujours bonnes à prendre et l’idée d’utiliser comme de profiter des accidents de parcours est d’une naïveté qui confine à nouveau avec le plaisir. Je reviens au sentiment de tout et son contraire, aligner jusqu’au pépin facilite parfois une redistribution des atouts. Lucie Bayens s’en sert. Je vais oser comme une archéologue dans les soubassements d’un métro : Ouais… je garde ça et ça. Le reste ? Hum ! Combien de temps nous reste t-il ? Deux jours. Heu ! Beeh ! Foutez moi tout cela au recyclage. Je l’imagine travailler de la sorte, en déblayant au bulldozer des tonnes de déchets, pour n’en extraire que quelques pommes de pin ayant servi à confectionner jadis d’horribles petites boîtes à épingles.4/ L’ignorance du hérisson et Conclusion.
Un temps d’adaptation & son service après-vente
Inutile encore une fois de se dire qu’un artiste contemporain parait capable à lui tout seul de faire la synthèse de plusieurs milliers d’années d’histoire de l’art ; certainement que l’homme qui ramassa sur son barbecue la dernière brochette confectionnée par un maître préhistorique de la cuisine traditionnelle, savant mélange de trois viandes : orignal, machairodus, mammouth pouvait trouver dans la contemplation sous la lune de cette dernière de quoi enrichir son paysage et illico l’envie de l’introduire à sa palette d’artiste ultra local vers Lascaux, Niaux ou autre places fortes de l’art contemporain pariétal. Lucie dit j’ai une naïveté féroce à assembler les beaux restes, nous devons absolument lui faire confiance. La clef est au pied de la lettre ; le f de féroce ou la n de naïve. Entre les deux tours nous allons nous prendre un bon coup de pied au cul Sous La Tente. (Cette dernière phrase pour donner toute sa consistance à ce texte universel doit être retirée).
Une fois l’écho dissipé, j’entends souvent, encore et toujours depuis mon enfance, cette phrase résonner en moi : Il me prend pour un autre.
Bordeaux, le 01, 10 et 11 avril 2012.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mon travail plastique commence par une promenade dans la nature apprivoisée en tant qu’espace public. Je prends des photos et glane des matières organiques. Les photographies balisent
le territoire dans l’environnement. Les matières sont assemblées pour créer des sculptures qui prennent la formes d’installations dans le white cube ou dans cette même nature. Je propose des agencements qui appartiennent au registre ludique et conceptuel.
Selon le théoricien, Thierry Davila : « L’artiste, et pas seulement le performer, devient un individu par essence mobile dont les pérégrinations fondent, ou du moins influencent fortement les réalisations» (1.) « Ces travaux se saisissent de la cinéplastique pour en faire le principe d’un nomadisme généralisé qui devient le coeur, la loi de la pratique artistique. » (2.)
J’erre dans des itinéraires choisis pour glaner l’infamie, chasser l’imprévu. Je me laisse dériver pour saisir ce précieux inattendu. Je m’empare de l’ennui et garde en moi la tradition du geste. Je transgresse cette mémoire pour apprendre des accidents, de l’hésitation et rendre poreuse la technique d’un objet à l’autre.
Bouleversée par les Beaux-restes, notion empruntée à Macha Makeïeff, je fais vibrer les signes et tisse des liens dans l’espace-temps à travers une expérience psychogéographique, bien que je ne souhaite pas respecter le protocole proposé par Guy Debord. Je m’associe à Rosemarie Trockel quand elle dit qu’elle crée « en réponse aux malaises, agressions sociales et contraintes qui fragmentent la société et les individus ».
Artiste du sensuel, je remets en cause avec jubilation les principes d’esthétisme dans le respect d’une certaine éthique. Avec délicatesse et sauvagerie, j’interroge l’art et ses limites. Je navigue parfois à l’aveugle dans la curiosité artistique. Mon travail est protéiforme teinté d’anthropologie, parfois d’anticipation. Par les glissements sémantiques, la relativité du grand et du petit, l’esthétique rupestre et l’humour, je cherche à ouvrir nos perceptions. Je me sers du territoire comme caisse de résonance. Je me joue des archétypes. Pour ce faire, je m’appuie sur la pérégrination, la dérive, des pratiques dites artisanales ou vernaculaires. Ce qui donne une certaine ambiguïté à mon travail nourri d’histoire de l’art contemporaine et parfois de cinéma et de littérature.
Ma démarche est rhizomique, la propagation y tient lieu de recherche de motif. La recherche de l’harmonie sculpturale anime mes séances de travail dans l’atelier, guidée par le sensible. Il y a ambivalence formelle ; ambivalence entre les thèmes de Nature et Culture, Histoire et Anticipation.
Je provoque la rencontre avec des techniques, des matériaux, des artistes, avec la science, des scientifiques, avec l’autre, pour finalement me rencontrer moi-même. L’art c’est la vie ; il faut vivre. Je chasse, entre autre chose, les représentations du tableau les Glaneuses de Millet durant mes errances photographiques. Ce qui donne lieu à des collections.
Comme Erwin Wurm et Joseph Beuys, j’estime que tout peut-être sculpture. Je revendique la liberté d’utiliser tout ce qui peut faire partie du quotidien pour créer des objets porteurs d’idées, de rêve, de curiosité, de critique, de questions… La scénographie et la technique sont au service de la forme qui n’apparaitrait ni sans engagement ni sans l’espoir de rencontre.
Le philosophe Michel Serres dit : « Mes racines dans Garonne ? Pas possible, il n’y en a pas de racine dans le fleuve, mais je me sens de la Garonne. J’ai toujours dans la tête le fleuve. J’ai beaucoup voyagé, mais j’ai toujours dans le sang l’eau de Garonne, c’est ça mon attachement.» Comme lui et le héros de Moby Dick, je ressens cet attachement à l’eau qui transpire dans un certain
nombre de mes projets, notamment dans Madeleine à bosse à Donostia. Le devenir-animal de Gilles Deleuze occupe également une place importante dans ma démarche. Je cherche à partir loin hors de moi, sortir de chez moi, me « déterritorialiser », à éprouver les extases d’un être-là qui s’ouvre à l’altérité.
1.Un trou dans la vie de Jean-Pierre Criqui. Repris par Thierry Davila.
2.Thierry Davila Marcher, Créer. Déplacement, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXe siècle. Ed. Regard.
Lucie Bayens.
2012